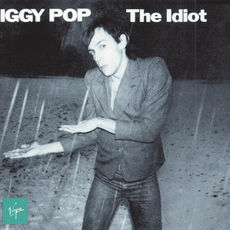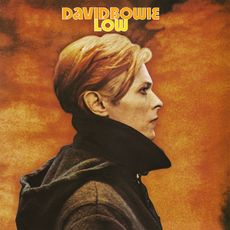Samedi 17 mai 1980, La Ballade de Bruno passe à la télé. Ce film fascinant et bien sombre n’est pas le plus célèbre du génial cinéaste barge Werner Herzog, mais son histoire d’ex-taulard qui part vivre le rêve américain avant de se faire sauter le caisson a profondément touché Ian Curtis devant son téléviseur ce soir-là. L’Amérique, le chanteur de Joy Division devait s’y envoler le lundi avec son groupe pour une longue tournée. Il choisira le suicide par pendaison dans sa cuisine, quelques heures après avoir visionné le film et s’être également enfilé The Idiot d’Iggy Pop. Curtis n’a que 23 ans, à peine plus de 50 chansons à son crédit et pourtant, plus de quarante ans après cette mort prématurée, la trace qu’il laisse dans l’histoire du rock est indélébile et toujours aussi influente.
Lorsque Joy Division prend forme en 1976, l’Angleterre est en plein séisme punk. Le 20 juillet, les Sex Pistols démontent la scène du Lesser Free Trade Hall de Manchester. Dans la salle, le guitariste Bernard Sumner et le bassiste Peter Hook rencontrent Ian Curtis pour lui proposer de tenir le micro du groupe qu’ils veulent monter. L’affaire ne s’appellera pas immédiatement Joy Division mais les Stiff Kittens puis Warsaw, clin d’œil à la chanson de Bowie Warszawa sur l’album Low. Tous comprennent vite que Curtis n’est pas comme les autres. Il lit Dostoïevski, Gogol, Nietzsche, Sartre, Burroughs, Ezra Pound, J. G. Ballard et Hermann Hesse et ses goûts musicaux sont plus éclectiques que ceux de ses contemporains. « Ian était bien plus éduqué que nous sur des artistes comme Can, Kraftwerk ou le Velvet Underground », précise Peter Hook au journaliste Jon Savage dans son livre essentiel de 2019, This Searing Light, the Sun and Everything Else – Joy Division: The Oral History. « C’est Ian qui nous a fait découvrir Iggy ou des choses comme ça, parce que Bernard et moi écoutions de la pop, du reggae, Led Zeppelin, Deep Purple. Mais Ian ne vous forçait jamais, il n'était pas du tout insistant avec nous, et c’était tout simplement génial d'être avec lui, il parfaisait notre éducation. »
Bowie et Iggy donc. Comme le krautrock de Kraftwerk, Neu! et Can. Mais aussi les Doors de Jim Morrison et Lou Reed. Mais lorsqu’en décembre 1977, Joy Division enregistre An Ideal for Living (le batteur Stephen Morris les a rejoints durant l’été), c’est l’énergie et l’urgence punk qui prédominent. Avec son riff de guitare sonnant comme les Damned, la chanson Warsaw qui ouvre ce quatre titres publié en juin 1978 ne ressemble finalement à rien de ce que sera le son Joy Division entré dans la légende. Un baptême du feu artistiquement en demi-teinte mais qui fera tout de même scandale entre des références à Rudolf Hess, l’adjoint du Führer, une pochette reproduisant une affiche des Jeunesses hitlériennes et ce nom de Joy Division, inspiré d'un groupe de prisonnières juives des camps de concentration violées quotidiennement par les SS… Le véritable envol de la bande de Ian Curtis aura lieu quelques mois plus tard avec Digital, single qui pose des bases vraiment originales. Une rythmique martiale, un chant plus austère et déclamatoire et surtout, derrière la console, un certain Martin Hannett…
Mancunien lui aussi, ce geek de studio a produit Spiral Scratch des Buzzcocks et apporte ses idées avant-gardistes à un groupe novice en technique d’enregistrement. Si la personnalité de Curtis est au cœur du génie de Joy Division, la vision sonore de Hannett lui est indissociable. En utilisant pléthore d’effets (dont le fameux DMX 15-80 de chez AMS qui vient de sortir, un delay numérique mentionné dans le titre Digital) et en mixant notamment les sons de batterie à ses nombreuses machines, il conçoit cette ambiance funèbre, froide, métallique et spacieuse à la fois, typique de la new wave naissante. Cet écho, comme hanté, de la batterie installe une atmosphère singulière que le producteur décuplera sur Unknown Pleasures, le premier album de Joy Division qui sort en avril 1979. C’est encore lui qui enregistre Curtis dans l’ascenseur de son studio pour Insight, qui demande à Rob Gretton, manager du groupe, de casser des bouteilles de lait sur l’intro de I Remember Nothing et à Morris d’utiliser les parties de sa batterie une par une, plutôt qu’en kit complet. Les quatre musiciens sont d’abord sceptiques et agacés par les options de ce Phil Spector du Nord qu’ils trouvent éloignées des canons orientés guitares du punk-rock. Mais Martin Hannett est sûr de son coup et monte la clim du studio à fond pour faire dégager le groupe et le laisser bidouiller les bandes tranquillement… Unknown Pleasures instaure une esthétique rigoureuse et austère, comme un pacte obsédant avec la mort et la folie qui rôdent. Sur des chansons comme I Remember Nothing, Joy Division ne mise pas sur la hargne et la rapidité du punk mais au contraire sur le côté atmosphérique, mélancolique. Des textures que les synthés utilisés, pas en odeur de sainteté chez les cadors du punk, rendent encore plus oniriques voire cauchemardesques…
Ian Curtis incarnera en gestes comme en mots ces architectures électriques et synthétiques révolutionnaires. Ses textes et sa personne. Celle d’un garçon assez secret mais sûr de lui dans sa détermination à chanter et qui a déjà noirci des carnets de paroles lorsqu’il rencontre les autres. Sa femme Deborah Curtis, qu’il épouse le 23 août 1975 à seulement 19 ans, décrira à Jon Savage ce mélange d’ambition et de désespoir. « Je pense qu'il voulait être comme Jim Morrison, quelqu'un qui devient célèbre et qui meurt. Être dans un groupe était très important, il était très déterminé là-dessus. Il avait toujours dit qu'il ne voulait pas vivre dans la vingtaine, après 25 ans. Je pense que c'était ce truc d’adolescent. Les ados aiment avoir l’air misérable, non ? Mais ça a changé et il a cessé d'en parler. Je ne pense pas qu'il l'ait oublié pour autant et je croyais même qu'il s’en sortirait. Et quand ce fut vraiment trop tard, il n'en parlait plus. On ne pouvait plus discuter avec lui, on ne pouvait pas savoir ce qui se passait vraiment.”
Au fond, Ian Curtis incarnait sa prose introspective, torturée et anthracite qui dépeignait son désespoir émotionnel dans la grisaille de l’industrielle et austère Manchester. Des mots forts amplifiés par cette voix excessivement grave, parfois plus parlée que chantée. « Ian a donné la direction », raconte Bernard Sumner. « Il était dans les extrémités de la vie. Il voulait faire de la musique extrême et voulait être totalement extrême sur scène, pas de demi-mesure. Quand on écrivait une chanson, il disait directement : faisons-la en plus maniaque ! Elle est trop classique là, ça doit être plus maniaque ! ». Le choc Ian Curtis est aussi visuel lors de performances live où ses violentes contorsions ressemblent à celles d’un papillon pris au piège dans une lampe halogène. Et si certains y voient les chorégraphies d’un néo-Nijinski épileptique, ils ne savent alors sans doute pas que le chanteur est justement rongé par cette maladie. Au point que, lors des concerts, personne ne décèle si ses crises sont authentiques ou jouées… L’aura de Joy Division grandit et les concerts deviennent de plus en plus intenses avec de plus en plus de crises d’épilepsie, bien réelles, elles. Comme l’écho d’une vie progressivement de plus en plus ingérable, comme le paroxysme d’un déchirement total alors que son couple se désintègre. Une épouse aimante qui a accouché d’une petite fille en avril 1979, une maîtresse rencontrée en tournée sept mois plus tard (la journaliste belge Annik Honoré) qui le fascine, et ce désir – évidemment impossible – de ne froisser personne… Le corps de Ian Curtis suit de moins en moins mais il assure les séances d’enregistrement en mars 1980 qui accoucheront de Closer, deuxième et dernier album de Joy Division. Tous les marqueurs d’Unknown Pleasures sont poussés à l’extrême dans une œuvre bicéphale, entre thèmes portés par les guitares (Atrocity Exhibition, Passover, Colony, A Means to an End, Twenty Four Hours) ou par les synthés (Isolation, Heart and Soul, The Eternal, Decades).
Lorsque ce deuxième album s’installe dans les bacs le 18 juillet 1980, Ian Curtis est déjà sous terre depuis deux mois. Avec Closer, le rock qui, ici, ne rolle pas trop, s’offre surtout la plus belle BO de son mal-être. Comme toujours chez Joy Division, le groove est viscéralement martial, les guitares stridentes au possible, le chant est emmitouflé dans une camisole, les rythmiques fleurent bon le cataclysme et les textes la claustrophobie. Le post-punk tient là de nouvelles Tables de la loi, héritées du Velvet des débuts, du Bowie berlinois, des Doors et du krautrock allemand. « Sur Closer, je cherchais à pousser encore plus loin la recherche d'une ambiance sonore », racontera Martin Hannett à Libération en 1990. « J'ai trouvé toutes sortes de procédés de réverbération. J'entrais des chiffres cabalistiques dans l'ordinateur. J'avais le sentiment de faire de la magie, j'étais orgueilleux. Je me disais : "Ce disque, c'est moi qui l'ai fait, on souffre quand on l'écoute !" Après coup, je me suis demandé si je n'étais pas allé trop loin dans la cristallisation de cette douleur. »
Control, The Movie - Official Trailer
SpotnickL’après-Ian Curtis sera finalement plutôt radieux pour les survivants de Joy Division qui deviendront New Order, l’une des premières unions réussies entre rock’n’roll et dance music. La vie du chanteur sera également mise en scène en 2007 dans Control, excellent biopic réalisé par le photographe Anton Corbijn. De son côté, Hannett œuvrera aux prémices du courant Madchester en produisant les Stone Roses et les Happy Mondays avant de mourir en 1991 à 42 ans. Le temps fera grandir l’aura et le mythe autour de Ian Curtis, auteur d’une œuvre finalement assez courte mais universelle, comme l’avait démontré le Français Marc Collin en 2004 avec son projet Nouvelle Vague, en revisitant en version bossa-nova sa plus belle chanson, Love Will Tear Us Appart. En faisant glisser la poésie de Curtis de la pluie de Manchester au soleil de Copacabana, il démontrait l’immensité de son potentiel artistique, et attisait d’autant les regrets.