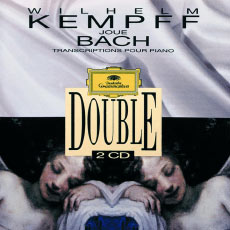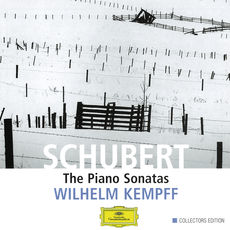Artiste d’un autre temps, Wilhelm Kempff (1895-1991) croyait à l’inspiration : il était entré en musique comme on entre en religion, avec une ferveur respectueuse pour les vieux maîtres qu’il servait. Avec son toucher de velours, son sens du phrasé et sa diction de conteur, l’art de Wilhelm Kempff était celui d’un rêveur éveillé, mi-poète, mi-devin, dans une époque où l’expression du sentiment primait sur tout. Il a souvent enregistré à plusieurs reprises ses compositeurs préférés, en particulier son dieu Beethoven, avec lequel on l’a si souvent identifié, laissant trois intégrales des sonates au fur et à mesure de sa propre maturation et de l’évolution des techniques d’enregistrement.
Fils d’un compositeur et organiste titulaire de l’église Saint-Nicolas de Potsdam, Wilhelm Kempff était baigné de musique, une langue qu’il comprenait avant même de parler. Dans ses souvenirs de jeunesse, publiés en 1955 en France (chez Plon) sous le titre Cette Note grave, Kempff raconte avec un vrai talent littéraire et un style délicieusement suranné combien la dévotion de la musique se confondait avec la religiosité de ce père luthérien. En famille, on ne parlait que de musique, que l’on pratiquait aussi naturellement qu’on respirait. Organiste lui-même, Kempff se souviendra toute sa vie de cette note grave de l’orgue qui avait éveillé l’enfant malingre à la musique. C’est sous la bienveillance de son père et le sourire lumineux de sa mère que le jeune enfant commence à étudier l’orgue et le piano avant d’obtenir deux bourses lui permettant d’entrer, à l’âge de 9 ans, au Conservatoire supérieur de Berlin (Hochschule für Musik). A la fin de la Première Guerre mondiale, il se produit en soliste dans le Concerto n° 4 de Beethoven avec l’Orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de son chef, le légendaire Arthur Nikisch. A 24 ans, le jeune Wilhelm Kempff est armé pour entreprendre une des carrières les plus étincelantes du XXe siècle.
Johann Sebastian Bach est évidemment la figure tutélaire de toute famille luthérienne un tant soit peu musicienne. Chez les Kempff, on l’a vu, les préludes, fugues et les chorals étaient le pain quotidien de père en fils. C’est donc tout naturellement ce compositeur qui accompagnera Wilhelm durant toute sa vie, d’abord comme organiste, puis comme pianiste. A l’extrême fin de sa carrière, il bouclera la boucle en enregistrant des préludes de chorals (souvent dans ses propres transcriptions), des suites, ainsi que les Variations Goldberg, qui n’étaient pas alors à la mode. Sans ornements ni reprises, l’enregistrement de Kempff nous semble aujourd’hui dénudé, voire austère, bien que teinté d’un certain romantisme. En 1980, il réalise son tout dernier enregistrement avec des extraits du Clavier bien tempéré.
Beethoven, le compagnon d’une vie
« Regarde, dit mon père, ici tu as les grandes notes, celles que l’on doit tenir longtemps ; et là, ce sont de toutes petites notes qui ne font que vibrer dans l’air. Sais-tu qui a inventé cela ?, me demanda-t-il, sur un ton de gravité presque solennelle.
Je pensais qu’il fallait dire : le bon Dieu.
Mais il dit : Beethoven.
Je dois avouer que je fus bouleversé par cette réponse. Ce nom que j’entendais pour la première fois, et de la bouche de mon cher père, suscita en moi des impressions que je sentais encore au-dessus de ma portée. Je pleurais, tout décontenancé. »
(Wilhelm Kempff in Cette Note grave)
Comme on le voit, l’amour que Wilhelm Kempff portait à Beethoven remonte à ses premiers émois musicaux. De fait, il en est devenu l'un des meilleurs interprètes, le jouant sans relâche, multipliant les enregistrements dès ses premiers disques dans les années 1920 jusqu’à la fin de sa vie, multipliant les intégrales en concert à travers le monde, comme celle de Tokyo en 1961, méticuleusement enregistrée et disponible aujourd’hui sur votre Qobuz. La sobriété de son jeu, l’intériorité de son art du chant le placent au premier rang. Jouant la sonate Hammerklavier en 1920 devant Sibelius lors d’un passage en Finlande, le compositeur lui déclara : « Vous n’avez pas joué comme un pianiste, mais comme un être humain. » Ce n’est pas un mince compliment de la part d’un être aussi renfermé que le compositeur finlandais.
Ce n’est pas facile pour l’honnête mélomane de s'y retrouver dans la jungle des enregistrements des 32 sonates, avec trois intégrales en studio, dont une incomplète, sans compter les nombreuses sonates isolées prises en concert ou éditées d’après des bandes radio – sans même parler de l’intégrale japonaise dont il est fait mention plus haut. Disons que les deux versions officielles enregistrées par DG sont absolument fiables : certains préféreront la première en monophonie sur laquelle les doigts du pianiste étaient plus agiles, d’autres choisiront sa dernière version en stéréophonie et qui constitue sa dernière vision beethovénienne.
Le choix est tout aussi cornélien pour les 5 concertos enregistrés à deux reprises « officiellement » avec l’Orchestre philharmonique de Berlin, en 1953 d’abord sous la direction de Paul van Kempen, puis en 1962 avec Ferdinand Leitner. En ce qui nous concerne, c’est la version de 1953 qui prime, avec des tempos plus vifs et un discours musical tenu de bout en bout par le soliste comme par le chef.
En 1970 paraissait chez DG, pour le bicentenaire de la naissance de Beethoven, une intégrale de ses œuvres saluée alors comme un coup de tonnerre, car c’était la première publication du genre. A cette occasion, on retrouvait les enregistrements des sonates et des concertos par le grand pianiste « maison », mais on lui demanda aussi d’enregistrer pour cette édition les Sonates pour violon et piano, avec un Yehudi Menuhin passablement diminué instrumentalement, et les Trios avec piano avec Henry Szeryng et Pierre Fournier. Quant aux Sonates pour violoncelle et piano, DG publia une belle version de concert enregistrée en 1965 à la salle Pleyel de Paris en compagnie de son vieux compère et ami Pierre Fournier, avec quelques retouches en studio.
Créez un compte gratuit pour continuer à lire