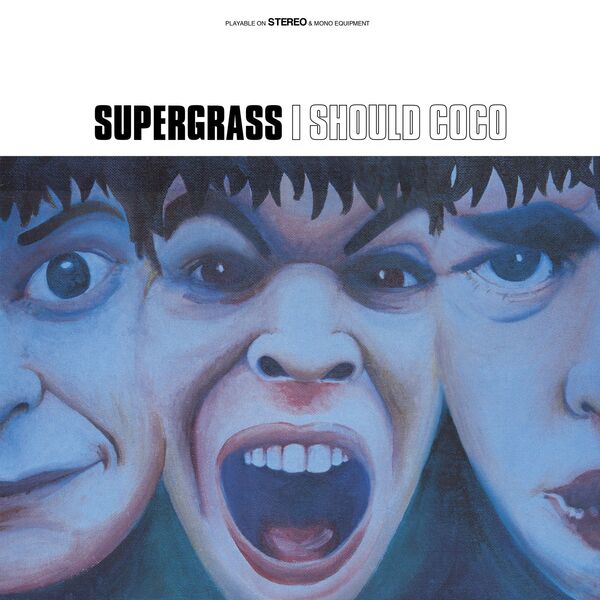Alors que la culture US traverse l’Atlantique avec le pessimisme du grunge, l’Angleterre de Thatcher accumule les années de conservatisme et creuse la fracture sociale, mise en évidence par la new wave, l’acid house, puis la vague Madchester. Quand, au printemps 90, les Stone Roses réunissent 25 000 personnes à Spike Island, l’Angleterre capte enfin le pouls de sa culture underground, portée par une jeunesse droguée en quête de liberté. Cette vague a un nom : britpop. Retour sur un courant bref mais intense, vite marketé et politisé, qui brassait sans distinction les sentiments de liberté, d’appartenance et de fierté nationale, et les groupes, qui se formaient et se déformaient à la vitesse de l’éclair.
The La’s - The La’s (1990)
Gloire fulgurante pour The La’s. A l’aube des 90’s, la bande née en 1983 (puis incessamment réorganisée), dont se démarque le tandem gagnant Lee Mavers et John Power, sort son album éponyme. Le seul et unique. The La’s est le fruit de deux ans de perfectionnisme et a été finalisé par Steve Lillywhit, dernier de la liste de producteurs envoyés par le label Go!Discs, après que Lee Mavers a usé des pointures comme John Leckie ou John Porter, producteur des Smiths. Véritable quête spirituelle, The La’s est davantage un concept que poursuit Mavers qu’un simple groupe. Le chanteur-guitariste méprise les pop stars. Il cherche autre chose, longtemps. Indéfiniment. Un single sort sur le marché pour payer les frais de studio qui s’accumulent. Ce sera There She Goes, morceau parfait haï par Mavers et qui deviendra leur plus gros succès. Puis, Go!Discs décide de publier l’album, faisant fi des critiques du combo. Avant même que le raz-de-marée britpop déferle, le quatuor de Liverpool ravive les Swinging Sixties avec une flopée de titres Merseybeat. Guitare acoustique (Looking Glass), envolées pop empruntées aux Smiths (Way Out), l’opus décrié par Mavers caracole en tête des ventes. Le perfectionnisme ayant ses limites, Mavers ne parviendra jamais à coucher un second album, laissant à la postérité ce classique de la pop britannique.
Suede - Suede (1993)
Ardant et juvénile, Suede embrase l’année 1993. Un pic émotionnel avait déjà été atteint en février, à l’occasion des Brit Awards. Brett Anderson, androgyne et sensuel, y performait le grandiose Animal Nitrate, un des trois singles sortis (avec The Drowners et Metal Mickey) avant l’album, qui tractèrent les ventes et allumèrent la mèche britpop. Déjà, la presse britannique s’empare du phénomène. Il faut dire que Suede, nom de scène choisi par Anderson pour la beauté sonore de ses lettres alignées, avait déjà une chaude réputation live. David Bowie lui-même, idole d’Anderson, s’était entiché de cette formation incandescente venue d’Haywards Heath à même d’incarner les nouveaux Smiths. N’en déplaise à Anderson, la production d’Ed Buller exacerbe réverbe et claviers, révèlant un chef-d’œuvre sinueux aux refrains accrocheurs. Parmi les unes racoleuses, le magazine Select pousse le vice jusqu’à titrer « Yanks Go Home! » avec Brett Anderson posant devant l’Union Jack. Le Londonien déteste, refuse toute récupération et ne veut pas céder aux sirènes d’une carrière américaine, qui tend les bras à Blur et Oasis.
Blur - Parklife (avril 1994)
En avril 1994, Blur, déjà dans la partie depuis Leisure (1991) puis l’excellent Modern Life Is Rubbish (1993), salué par la critique, lance Parklife et exporte la britpop. Critiquant l’inconsistance américaine, ce troisième opus décrit en 16 titres la fin d’un siècle étrange, un quotidien doux-amer avec une ironie piquante typiquement british. Avec son accent bourgeois, Damon Albarn et sa gueule d’ange envoûtent. Jusqu’à l’amie de Brett Anderson, Justine Frischmann d’Elastica. Enregistré entre novembre 93 et janvier 94 à Londres, Parklife est un patchwork pop entre les Beatles, les Kinks et Human League, composé de mélodies acidulées (To the End), entêtantes (Girls & Boys) et abrasives parfaitement découpées par Stephen Street, l'homme derrière The Queen Is Dead ou Meat Is Murder des Smiths. A sa sortie, Damon Albarn, Graham Coxon (guitare), Alex James (basse) et Dave Rowntree (batterie), forment le quatuor le plus en vogue d’Angleterre.
Oasis - Definitely Maybe (1994)
Toujours en 1994, à l’été, le paysage d’Albion s’étoffe. Oasis pulvérise les charts avec Definitely Maybe, dont les singles Supersonic, Shakermaker et Live Forever, égrenés dès le printemps, avaient fait grimper la cote. Signé par Alan McGee sur l’indépendant Creation Records, qui se détourne du shoegaze, Oasis enregistre péniblement son premier effort, d’abord à Valley Monnow, avec Dave Batchelor, puis avec Mark Coyle et Noel Gallagher aux commandes dans les Cornouailles. Les bandes sont ensuite reprises et confiées par le label à Owen Morris, qui doit faire avec ce qu’il a : d’innombrables couches de guitares saturées empilées par Noel recouvrant les voix. Démêlant l’ensemble avec une technique inédite, le « brick walling », Owen Morris fait des miracles. Il parvient à conserver un volume sonore puissant et râpeux, donnant à l’opus un charisme live tout en clarifiant le tout. Ecrit et gratté par Noel, déclamé par Liam, Definitely Maybe rime simple. Comme ce « she’s sniffin in her tissue, sellin’ The Big Issue » sur Supersonic. La poésie droguée du premier éclôt dans la diction désabusée du second, empruntée à son modèle mancunien Ian Brown. Après des odes libératoires, dont les riffs puisent sans complexe dans la pop des Beatles (Shakermaker, Live Forever) et les 70′s glam de T. Rex (Cigarettes & Alcohol), tout en gardant un côté rock nerveux (Bring It On Down), le combo clôture en beauté avec l’acerbe Married With Children. Ici, pas d’autocomplaisance, juste un je-m’en-foutisme impérieux. Plébéiens de Manchester, adeptes de foot et de frappes, les Gallagher apparaissent vite comme le double négatif des Londoniens de Blur.
Radiohead - The Bends (1995)
« Toute la britpop m’énervait. Je détestais. C’était regarder en arrière et je ne voulais en aucun cas en faire partie. » A l’occasion des 20 ans d’OK Computer, en 2017, Jonny Greenwood et Thom Yorke donnaient dans le magazine Rolling Stone leur avis sans concession sur la britpop. Alors pourquoi les y relier ? Parce que si l'on considère la britpop comme une réaction de la scène anglaise au Zeitgeist des 90’s, Radiohead fait partie de l’équation. Porté par le succès de Creep sur Pablo Honey (1993), le quintet d’Oxford suffoque de la surmédiatisation. Voulant s’éloigner du commercial à guitare pour un nouveau langage musical, Yorke et Greenwood piochent dans le folk et l’électronique, dessinant un rock stellaire, avant-gardiste. La pop expérimentale de Björk (Debut, Post), les guitares électriques de R.E.M., les échantillonnages de DJ Krush (Strictly Turntabilized ou Meiso chez Mo’Wax), les pianos et batteries du Bitches Brew de Miles Davis ou les Talking Heads sont autant de sources d’inspiration qui nourriront les textures de The Bends. Attendu par EMI, qui réclame LE single qui succédera à Creep, Radiohead s’enferme neuf mois dans les studios RAK de Londres, épaulé par John Leckie qui a récemment produit les Stone Roses. Sous pression, les sessions se révèlent infructueuses. Greenwood s’acharne à trouver le bon son, le groupe n’arrive pas à trier la pile de chansons sur laquelle il travaille. L’enregistrement se poursuit donc au Manor Studio d’Oxford après une tournée salutaire, puis est mixé à Abbey Road par Leckie. Les morceaux sont lumineux, le répertoire torturé. Yorke, plus confiant, appuie ses aigus, la guitare de Greenwood harponne, nerveuse, jusqu’à ce noueux Street Spirit. Alors que les hérauts de la britpop puisent dans les 60's, Radiohead construit l’avenir.
Supergrass - I Should Coco (1995)
« I Should Coco ne ressemblait à rien de ce qui se faisait – Oasis sonnait comme s’ils étaient sous Mogadon comparé à ça. Nous avons vite été embarqués dans la britpop. » Voilà le regard que porte aujourd’hui Gaz Coombes, 19 ans à l’époque de I Should Coco, premier album de Supergrass. Derrière cette pochette d’un goût douteux se cache un des plus brillants albums de la décennie, écoulé à 1 million d’exemplaires – dont la moitié en Angleterre. Repéré par Parlophone après la sortie du single Caught by the Fuzz chez l’indépendant Backbeat, le trio adolescent formé par Gaz Coombes, Danny Goffey à la batterie et Mick Quinn à la basse encapsulent 40 minutes expéditives de pop psyché punk héritée des Kinks, Rolling Stones, Jam et autres Buzzcocks. La fraîcheur candide et incandescente qui s’en dégage fait le sel de cet opus sur la jeunesse anglaise, dont Alright sert d’hymne. « We are young, we run green / Keep our teeth nice and clean / See our friends, see the sights / Feel Alright », répète Gaz. A l’opposé de la mélancolie noyée de Radiohead, Oxford s’offre un bain de jouvence électrique.
Oasis - (What’s the Story) Morning Glory ? (1995)
« J’avais fait promettre à mon manager de m’offrir une Rolls. J’ai une Rolls, Liam une Rolex. C’est super car je ne sais pas conduire et Liam ne sait pas lire l’heure. » Perchés en haut des charts, couchés sur les pages glacées des magazines, ayant atteint leur statut de rock star promis dans Definitely Maybe (Rock’n’roll Star), les mégalos Gallagher poursuivent leur ascension avec (What’s the Story) Morning Glory ?. Alan White a remplacé Tony McCaroll à la batterie, Owen Morris a été dépêché à la production. Malgré une sévère altercation entre Noel et Liam, l’enregistrement sera rapidement soldé. Entamé avec Hello, ce second opus enchaîne les hymnes rock trouvés par Noel Gallagher, la nuit, le nez enfariné. On y retrouve les cultes Wonderwall, Don’t Look Back in Anger, Some Might Say et Champagne Supernova avec un solo de Paul Weller. Entre saturations rock, trésors pop et ballades dépouillées, Noel, qui a gardé pour lui toutes les compositions jusqu’à deux semaines avant les sessions, se surpasse. C’est plus édulcoré, toujours aussi bruyant mais plus riche, du piano de Don’t Look Back in Anger aux cordes de Wonderwall en passant par l’harmonica de The Swamp Song. Avec 15 millions d’albums vendus – un score que McGee pressentait –, Morning Glory inaugure l’Oasismania dont ne se relèveront jamais les Gallagher.
Pulp - Different Class (1995)
1995 est l’année britpop par excellence. C’est aussi l’année de sortie de ce Different Class et du tube Common People, dans lequel Jarvis Cocker écrit la fascination malsaine pour la classe populaire d’une Grecque qu’il draguait. Cocker et Pulp ne sont pourtant pas nés avec la britpop mais presque vingt ans plus tôt. En 1978, à Sheffield, Jarvis et son groupe enfilent les disques sans réel succès, loupant la gloire à chaque rendez-vous. Avec His ‘N’ Hers, dont Cocker déteste la production d’Ed Buller, mais surtout avec Different Class, son cinquième effort, Pulp surfe enfin sur une vague qui porte loin. Portant un regard acerbe sur les luttes de classe, l’opus malaxe pop anglaise, disco protéiforme (Disco 2000), expérimentations synthétiques de plus de 6 minutes (F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E), glam classe à la Bowie ou déjanté façon Roxy Music, pour former une pâte brillante prête à être lustrée par le phénomène britpop. Bill Brummond ayant refusé, on retrouve à la production Chris Thomas, qui fera des merveilles. Notamment sur Common People, que Cocker avait ébauché sans conviction sur un petit Casio. Véritable outsider à la hauteur de son auditoire, Pulp, avec sa pop déphasée à textes sexuellement chargés et crus, devient la voix sans filtre et l’un des groupes les plus acides et fascinants d’une époque étrange.
Suede - Coming Up (1996)
Précurseurs perdus dans une compétition dominée par Blur et Oasis, les membres de Suede font tout pour rester en dehors de cette sphère qu’ils jugent formatée. Aujourd’hui encore, Brett Anderson estime avoir fait partie malgré lui de cette déferlante. Après Suede (1993) puis Dog Man Star (1994), le combo originaire du sud de Londres voit partir son guitariste Bernard Butler pour dissensus en plein enregistrement, déchirant le duo flamboyant formé avec Brett Anderson. Qu’importe, le dandy décadent, alter ego pâlot et filiforme du lettré Jarvis Cocker, irradie avec Coming Up, carton de l’année 96, incluant les irascibles Trash et Beautiful Ones, mais aussi les 7 minutes de la romance pop The Chemistry Between Us, Filmstar ou Lazy. Ouvertement inspiré par Bowie et le glam rock des 70’s, ce troisième opus s’écarte de la noirceur complexe des précédents pour déverser un flot de riffs aigus et d’accents dramatiques autour de la voix haut perchée d’Anderson. Une merveille primale quasi punk à la pochette culte signée Peter Saville, héros de l’enfance d’Anderson aux côtés de Joy Division.
The Verve - Urban Hymns (1997)
Bitter Sweet Symphony, la quintessence de The Verve ? Inspiré par les Stones, ce tube n’aura rien rapporté à la bande de Richard Ashcroft, si ce n’est un procès perdu contre Allen Klein, fondateur du label Abkco qui héberge celle de Jagger. The Verve avait bien récupéré les droits d’utilisation de The Last Time des Stones (qui reprenait déjà les Staples Singers), mais Klein a estimé qu’ils avaient pioché plus profond et a récupéré les royalties de la Symphony. Mais il y a d’autres bonnes chansons sur ce Urban Hymns, qui arrive après l’avalanche trip hop. A cette époque, Ashcroft et ses lads venus de Wigan, dans le nord de l’Angleterre, relèvent un temps le nez de la poudre. Elégantes, les orchestrations du groupe crayonnent un spleen anglais rythmé par des matins cotonneux (Velvet Morning), que les drogues n’arrivent pas à édulcorer (The Drugs Don’t Work). D’abord shoegazien avec A Storm in Heaven, puis funk sur A Northern Soul, The Verve suit le sens du vent. Entre la pop languide d’Oasis (Lucky Man, Weeping Willow) et celle, gazeuse, de Radiohead (Space and Time), The Verve conserve son héritage mélodique, fait d’arrangements grandiloquents et de pédales d’effets (The Rolling People). En témoignent les quinze minutes de Come On/Deep Freeze. Sorti au crépuscule de la britpop, Urban Hymns ravive la flamme quelques moments avant son extinction.