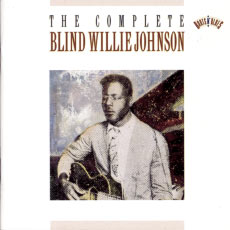En octobre 1990, un musicien de blues a vendu 100 000 albums en un mois. Les chiffres s’élevaient à 300 000 au printemps 91, pour finir par dépasser le million d’exemplaires. Une performance d’autant plus remarquable que ce musicien était mort un demi-siècle plus tôt, après avoir enregistré seulement 29 chansons (et 12 versions alternatives) en 1936 et 1937. Ce musicien, vous l’avez peut-être reconnu, c’est Robert Johnson, la star du country blues, qu’on appelle aussi le blues traditionnel. L’homme dont les chansons anxieuses et le jeu de guitare magique a irrigué les œuvres de Clapton, des Stones, de Led Zeppelin. L’homme dont la chanson Sweet Home Chicago est devenue un tube pour les Blues Brothers. L’homme dont la légende a fait entrer le diable et le crossroad dans la mythologie du blues. Les disques originaux du chanteur du Mississipi sont sortis de son vivant : une douzaine de 78 tours sur le label Vocalion. Mais cinquante ans plus tard, un nouveau support de musique enregistrée faisait son apparition et balayait tout ce qui précédait, cassettes et 33 tours en vinyle. C’est le compact-disc (CD pour les intimes), et c’est grâce à une intégrale dans ce format (The Complete Recordings) que Robert Johnson est devenu vendeur millionnaire. Quel étrange voyage temporel, où la technologie la plus moderne permet la redécouverte de la musique la plus ancienne. Ce n’était pas une première pour le bluesman, qui avait déjà connu une renaissance en 1961 grâce à la compilation King of the Delta Blues, sortie en 33 tours, le format album qui, depuis quelques années, remplaçait le vieux 78 tours. Et pour l’anecdote, c’est en 1934 que le terme “hi-fi” a été inventé.
Pour résumer l’histoire du support physique, le CD a enterré le 33 tours, qui a enterré le 78 tours (qui avait lui-même enterré le cylindre). Mais rien n’a eu la peau du vieux blues. Puisqu’il sera ici question du blues le plus ancien et de l’influence des techniques d’enregistrement sur son essor, remontons d’abord l’histoire du son capturé. Dans son livre L’Histoire du disque et de l’enregistrement sonore (Carnot, 2004), Daniel Lesueur rappelle qu’en 1548, dans Pantagruel, Rabelais imaginait les bruits d’un champ de bataille pris dans la glace en hiver, et libérés au printemps par la fonte des glaces. En 1656, Cyrano de Bergerac rêve d’“un livre miraculeux qui n’a ni feuillet ni caractère. Enfin un livre où pour apprendre, on n’a besoin que des oreilles.” Piéger le son et le restituer, comme la photographie enferme la lumière : ce fantasme devient bien réel dans le dernier tiers du XIXe siècle, avec l’invention du phonographe et du gramophone.
Dans l’histoire du blues, il y a plusieurs chapitres. Celui qui nous intéresse aujourd’hui est titré “country blues”, le blues rural. Mais les anglophones le repèrent parfois dans le temps plutôt que l’espace, en l’appelant “pre-war blues”, le blues d’avant-guerre. Pas la guerre des étoiles ni celle du Golfe, mais la Deuxième Guerre mondiale. C’est celui de l’âge d’or. Mais comment pouvait sonner le blues avant la Première Guerre mondiale ? Nul ne le sait, puisqu’il n’a pas été enregistré. Avant les disques, la musique populaire était diffusée sous forme de partitions, de cahiers de chansons. Et le blues existait avant les disques de blues, joué par des musiciens itinérants dans les campagnes et les bourgades du sud des Etats-Unis, et parfois sur les quais de gare. C’est là, en 1903, sur le quai de la gare de Tutwiller dans le Mississippi, en attendant un train, que William Christopher “W.C.” Handy a découvert le blues. A côté de lui, un homme noir en haillons, avec les orteils qui sortaient de ses chaussures, chantait et jouait de la guitare en pressant un couteau sur les cordes, à la façon hawaïenne en vogue à l’époque.
Fils d’esclaves affranchis né dans le Sud, W.C. Handy était compositeur et musicien. Il allait transcrire le blues de la gare de Tutwiller sur partition et le mêler dans ses compositions au ragtime et au jazz, pour en faire une musique à la mode en ville. Ainsi est née sa légende de “père du blues”, avec des chansons aussi célèbres que Saint-Louis Blues ou Memphis Blues. Dans les années 1910, des chansons sont composées qui portent le nom blues. Comme Dallas Blues de Hart Wand en 1912, ou The Weary Blues d’Artie Matthews en 1915. Mais ce ne sont pas des blues, et encore moins des chansons dans la tradition orale du country blues, plutôt des pièces de ragtime instrumentales. Pour entendre le premier disque chanté estampillé “blues”, il faut attendre 1920 et le Crazy Blues de Mamie Smith, écoulé à 1 million d'exemplaires en six mois. C’est un beau morceau de jazz ancien, accompagné par un orchestre de cuivres, mais ce n’est toujours pas un “authentique” blues rural. Mamie Smith est une comédienne, danseuse et chanteuse de jazz, qui vit à Harlem. Idem pour le Working Man Blues de Joe “King” Oliver, enregistré en 1923 à Chicago, avec Louis Armstrong dans l’orchestre. Comme on dit aujourd’hui : c’est de l’urbain.
Create a free account to keep reading